
Bible, Histoire, Archéologie
Bible,
Histoire,
Archéologie
La Guéniza
du Vieux-Caire, en Égypte
Le terme araméen guénizah (de GNZ, « cacher », « être précieux ») désigne une salle, attenante à la synagogue, destinée à recevoir les manuscrits de la Loi devenus inutilisables par l’usure de l’âge ou la manipulation cultuelle : tenus pour sacrés, car ils contenaient le nom divin, ils ne devaient être ni détruits ni profanés.
La Guénizah
 Le mot guénizah désigne une ancienne forme de dépôt juive. Ce mot provient de ganaz, et signifie : «trésor», «cachette», «abri», «archives». Appliqué aux documents, il équivaut au mot «enterrement». Tout document trop usé pour pouvoir encore servir était dissimulé pour éviter une profanation car, selon les Juifs, le contenu d’un livre s’en va au ciel, comme l’âme. «Je vois le parchemin brûler, et les lettres volant dans l’air», furent les dernières paroles du martyr R. Hanina ben Teradyon (sous Hadrien, IIe siècle) se rendant sur le bûcher enveloppé de rouleaux de la Loi. Parfois on ensevelissait des exemplaires usagés du Pentateuque dans les tombes des lettrés. Mais habituellement les livres étaient simplement enterrés ou bien déposés dans une sorte d’appentis avoisinant la synagogue.
Le mot guénizah désigne une ancienne forme de dépôt juive. Ce mot provient de ganaz, et signifie : «trésor», «cachette», «abri», «archives». Appliqué aux documents, il équivaut au mot «enterrement». Tout document trop usé pour pouvoir encore servir était dissimulé pour éviter une profanation car, selon les Juifs, le contenu d’un livre s’en va au ciel, comme l’âme. «Je vois le parchemin brûler, et les lettres volant dans l’air», furent les dernières paroles du martyr R. Hanina ben Teradyon (sous Hadrien, IIe siècle) se rendant sur le bûcher enveloppé de rouleaux de la Loi. Parfois on ensevelissait des exemplaires usagés du Pentateuque dans les tombes des lettrés. Mais habituellement les livres étaient simplement enterrés ou bien déposés dans une sorte d’appentis avoisinant la synagogue.
Image ci-contre : fragments de divers manuscrits de la guénizah du Caire avant conservation et classement. © University of Cambridge et Bodleian Libraries, University of Oxford.
Heureusement pour les scientifiques, on ne réservait pas ces cachettes uniquement aux manuscrits hors d’usage. Au cours des siècles, les guénizot (pluriel de guénizah) abritèrent souvent des « invalides », c’est-à-dire des livres auxquels manquaient quelques pages, ainsi que ceux « tombés en disgrâce », autrement dit les livres classés d’abord parmi les Écritures sacrées, mais dont l’inspiration divine fut ensuite contestée. La guénizah servait ainsi non seulement à protéger les « bons livres » contre la profanation, mais aussi à défendre les fidèles contre les « mauvais livres ».
D’autres ouvrages
 À côté de ces livres sacrés, on trouvait dans les guénizot des ouvrages séculiers qui donnaient des détails sur l’Histoire juive, ainsi que des documents légaux, contrats, lettres de divorce, etc., tous rédigés en hébreu ou en araméen. Les Juifs attribuaient un caractère sacré à tout écrit ressemblant par le fond ou par la forme à la Bible ; il leur répugnait donc de traiter ces manuscrits, devenus inutiles, mais rédigés en caractères hébraïques, comme des objets de rebut, et ils les reléguaient dans les guénizot.
À côté de ces livres sacrés, on trouvait dans les guénizot des ouvrages séculiers qui donnaient des détails sur l’Histoire juive, ainsi que des documents légaux, contrats, lettres de divorce, etc., tous rédigés en hébreu ou en araméen. Les Juifs attribuaient un caractère sacré à tout écrit ressemblant par le fond ou par la forme à la Bible ; il leur répugnait donc de traiter ces manuscrits, devenus inutiles, mais rédigés en caractères hébraïques, comme des objets de rebut, et ils les reléguaient dans les guénizot.
En Europe, plusieurs cimetières réservaient un espace pour l’enterrement de ces textes. En Orient, les musulmans et les Coptes agissaient de même avec leurs livres sacrés : mus par un sentiment de respect, ils enfouissaient de tels documents entre les pierres des murs, voire dans un grenier ou une tombe.
Image ci-contre : le banc de travail d’un conservateur Lewis-Gibson. © University of Cambridge et Bodleian Libraries, University of Oxford.
Dans l’ancien monastère orthodoxe copte de Sohag (au sud d’Assiout sur la rive gauche du Nil), par exemple, appelé aussi le Monastère rouge, une fosse spéciale accueillait les livres de prières endommagés, les vêtements sacerdotaux usés, et les objets caducs ayant jadis servi au culte.

L’intérieur de la synagogue Ben Ezra du Caire, en Égypte, après sa complète restauration. Elle contenait une Guénizah, un dépôt d’archives sacrées d’environ 200 000 manuscrits juifs datant de 870 à 1880. Au premier plan de la photo de droite se trouve un catafalque qui contiendrait selon la tradition (légende ?) les restes du prophète Jérémie qui s’était joint aux Juifs fuyant les Néobabyloniens (Jérémie 43). © Christian Marquant de Clio, avec son aimable autorisation.
Des couvre-chefs et des semelles de chaussures !
Mentionnons deux objets des plus communs où l’on découvrit souvent des manuscrits : les couvre-chefs et les chaussures. Plus d’un fabricant de « tarbouches » (fez, coiffe égyptienne) se servit de papyrus ou de feuilles de papier pour donner à ses coiffures la rigidité nécessaire, et, sans le savoir, des Turcs et des Égyptiens se protégèrent longtemps la tête avec des manuscrits valant des fortunes. Les érudits qui fouillaient fiévreusement les tombes, les couvents et les décombres à la recherche de quelque rare document, ne se doutaient pas que leur domestique ou le cafetier du coin le portait peut-être cousu dans la doublure de son « tarbouche ».
D’autre part, plus d’un cordonnier de jadis « renforçait » les semelles des chaussures en plaçant quelques feuilles de papyrus entre deux morceaux de cuir, procédé perfectionné par nos savetiers contemporains qui utilisent, pour le même but, le carton. Cette pratique, citée comme un exemple de malhonnêteté particulière à notre époque, remonte, en fait, à la plus haute antiquité. Dès les temps anciens, des cordonniers indélicats trompaient leurs clients… pour le plus grand bonheur des scientifiques de notre temps qui ont ainsi récupéré plus d’une fois des manuscrits rarissimes dans de vieilles chaussures (Grohmann, Papyri) et même tout récemment un fragment de papyrus contenant une partie de l’Évangile de Marc parmi les couches d’un masque d’une momie égyptienne datant de la fin du Ier siècle de l’ère chrétienne (Craig Evans, professeur du Nouveau Testament à l’Université Acadia Divinity College à Wolfville (Nouvelle-Écosse, Canada) !
La guénizah de loin la plus célèbre, pour l’importance tant numérique que qualitative des textes qui y étaient entreposés, est la Guénizah du Vieux-Caire, découverte en 1864 par Jacob Saphir, et principalement étudiée par le rabbin et académicien anglais Solomon Schechter (1875-1915).
L’équipe Lewis-Gibson discute d’un fragment. De gauche à droite, Rebecca Goldie, Mary French et Emma Nichols. © University of Cambridge et Bodleian Libraries, University of Oxford.
L’équipe Lewis-Gibson discute d’un fragment. De gauche à droite, Rebecca Goldie, Mary French et Emma Nichols.
Prélèvement d’échantillons de parchemin pour l’analyse du collagène. © University of Cambridge et Bodleian Libraries, University of Oxford.
Prélèvement d’échantillons de parchemin pour l’analyse du collagène.
Analyse des pigments réalisée par fluorescence X (XRF) et l’analyse adhésive par spectroscopie infrarouge (FT-IR). © University of Cambridge et Bodleian Libraries, University of Oxford.
Analyse des pigments réalisée par fluorescence X (XRF) et l’analyse adhésive par spectroscopie infrarouge (FT-IR).
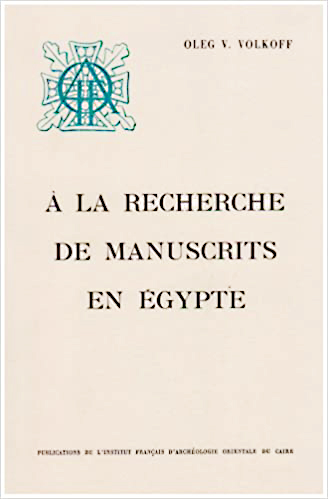
Pour en savoir plus
VOLKOFF Oleg, À la recherche de manuscrits en Égypte
Institut Français d’Archéologie Orientale du Caire, 1970.



